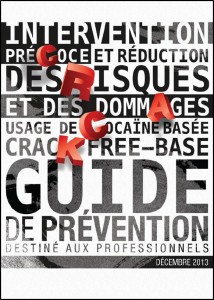Lundi 23 juin 2014
Télécharger le bulletin d’inscription 2014
Les drogues et leur usage suivent l’évolution des mœurs. La représentation des drogues elles-mêmes accompagne cette évolution. Par exemple, les représentations attachées à la cocaïne ont radicalement changé au cours de ces dernières années. Elle est en effet passée, pour reprendre la terminologie de R. Saviano, du statut « d’apéritif bourgeois » dans les années 80 à celui d’une drogue de plus en plus répandue, démocratisée, banalisée et facilement accessible tant en terme de coût que de disponibilité.
Nous savons depuis longtemps qu’au-delà du produit lui-même, de la molécule pharmacologiquement active, l’essence des drogues réside dans les représentations que l’on s’en fait. L’opposition entre drogues licites et illicites en est la plus claire illustration. Le caractère illégal d’une drogue ne s’établit pas sur des critères exclusivement pharmacologiques ou médicaux, mais aussi sur des critères moraux, économiques ou politiques. Pendant longtemps, les drogues licites ont véhiculé des valeurs de convivialité, d’intégration, de force, de bien-être etc., alors qu’à l’inverse, les drogues illicites étaient synonymes de déchéance et de malheur. Or, depuis le rapport Roques, le curseur s’est déplacé : les drogues licites commencent à être perçues comme largement aussi dangereuses que les autres, si bien que certains se posent la question de savoir s’il ne serait pas opportun de mettre fin à la prohibition
Programme :
(la journée commence à 10h et se termine à 17h.)
Accueil à partir de 9h30 au 5 bis rue des colonels renard, 75017 Paris.
Voyage des drogues dans l’imaginaire social à travers le temps.
Myriam Tsikounas, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du master recherche « Histoire et audiovisuel ».
La représentation des drogues dans la publicité.
Patrick Baudry, sociologue, université Michel de Montaigne, Bordeaux III.
Les représentations de la drogue dans l’art.
Mario Blaise, psychiatre, Centre médical Marmottan, et Antoine Perpère, commissaire de l’exposition « sous influence, drogues et artistes » à la Maison rouge.
Les grandes campagnes nationales de prévention sont-elles efficaces ?
Jean-Michel Costes, sociologue
Fil rouge : Dr. Michel Hautefeuille, psychiatre, Centre Médical Marmottan, paris
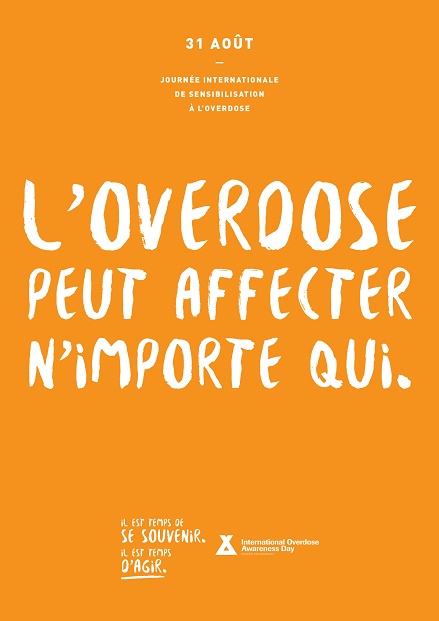




 Le 4 février, le Président de la République a indiqué de la manière la plus claire que le prochain plan de lutte contre le cancer devrait intégrer des mesures de prévention contre la consommation d’alcool qui est à l’origine de 16 000 décès par cancer chaque année. Le Président a indiqué que des informations « visibles et lisibles » devraient être apposées sur tous les contenants de boissons alcooliques, afin d’inciter les consommateurs à réduire les risques.
Le 4 février, le Président de la République a indiqué de la manière la plus claire que le prochain plan de lutte contre le cancer devrait intégrer des mesures de prévention contre la consommation d’alcool qui est à l’origine de 16 000 décès par cancer chaque année. Le Président a indiqué que des informations « visibles et lisibles » devraient être apposées sur tous les contenants de boissons alcooliques, afin d’inciter les consommateurs à réduire les risques.