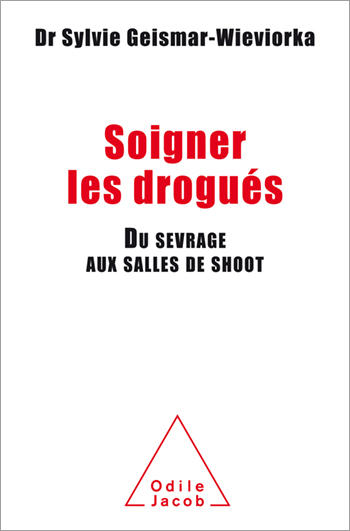 Dans le contexte de l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque, nous revenons sur la parution récente d’un ouvrage, « Soigner les drogués, du sevrage aux salles de shoot »
Dans le contexte de l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque, nous revenons sur la parution récente d’un ouvrage, « Soigner les drogués, du sevrage aux salles de shoot »
La loi de 1970 qui permet de punir d’un an de prison le simple usage de stupéfiants commence à paraître vraiment archaïque, au point que bon nombre d’usagers – particulièrement chez les millions de jeunes consommateurs récréatifs de cannabis – ignorent jusqu’à son existence. Il est d’ailleurs souvent dit qu’elle n’est pas appliquée, sinon sous forme d’injonction thérapeutique, ou de rappel à la loi…
Au point aussi que ce qui pourrait faire débat serait non une dépénalisation de l’usage, mais une forme de légalisation contrôlée : ce fut en 2014, le thème du livre des docteurs Michel Hautefeuille et Emma Wieviorka, paru chez Odile Jacob, dans lequel les auteurs dressent la liste des nombreux arguments sérieux en faveur de cette légalisation. Ils y voient certes des avantages sanitaires (produits contrôlés, usage dédramatisé…), mais surtout des intérêts sociétaux (lutte contre l’offre illégale, fin d’un illégalisme populaire, réorientation des actions de police et de justice), juridiques (fin d’une loi interdisant le libre usage de son propre corps), économiques (sources de revenus pour les Etats, et non plus pour les mafieux, les cartels ou les terroristes.) Au point que la simple dépénalisation (la fin de la criminalisation de l’usager) leur paraît « une réponse frileuse », une « fausse solution dont les conséquences seraient largement négatives ».
De style moins polémique ou pamphlétaire, un autre ouvrage est paru, toujours chez Odile Jacob, signé du Docteur Syvie Geismar-Wieviorka.
« Soigner les drogués, du sevrage aux salles de shoot » explique comment cette histoire déjà ancienne – qui commence avec la loi de 1970 – a conduit en 2013 le conseil d’État à refuser une expérimentation de salles de consommations supervisées, alors que pour une majorité (presque consensuelle) de praticiens et d’intervenants de terrain cette mesure n’apparaît que comme un complément utile, et certainement non suffisant, à la panoplie d’outils de réduction des risques et des dommages chez les usagers de substances illicites.
L’auteur nous rappelle les grandes périodes de ce qui fut « l’intervention en toxicomanie » avant de devenir « l’addictologie » : les débats précédant l’adoption de la loi (avec les interventions de Robert Boulin, de différents députés, du Pr. Olivenstein et du Pr Deniker), la phase « pionnière » de l’intervention (durant laquelle « Olive » tint le rôle de Monsieur Drogue) avec le mythe de la « désintox » (la cure et la post-cure), et, selon les termes du sociologue Henri Bergeron, l’hégémonie du paradigme psychanalytique chez les « thérapeutes » (la « vraie cure »), le choc du sida, l’évolution des pratiques et des conceptions, la généralisation des traitements de substitution, le développement des actions de proximité auprès des usagers, enfin l’acceptation du grand cadre de la réduction des risques et des dommages. La première mesure fut la mise en vente libre des seringues par Michèle Barzach en 1987, inaugurant une remise en cause radicale des buts et des moyens de l’intervention. Enfin, après le « rapport Parquet » de 1995, remplaçant « toxicomanie » par usage, abus ou dépendance, le « rapport Roques » de 1997 sur la dangerosité des drogues conduit à l’intégration de l’alcool et du tabac dans les prérogatives de la mission de lutte contre… la toxicomanie. En 2002, un rapport du Sénat à l’intitulé inquiétant (Drogues : l’autre cancer) finit par concéder que la réduction des risques doit rester au centre de l’action sanitaire, dans un contexte de répression renforcée…
Car la répression – y compris les peines frappant les usagers simples de cannabis – n’a en fait jamais cessé. Elle a même augmenté, et la réponse pénale est fréquente : en 2010, 1547 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme. La guerre à la drogue n’a cessé d’être une guerre aux « drogués », les tensions entre activités policières et dispositifs de réduction des risques étant de fait structurelles : d’un côté, on prescrit des opiacés, on distribue des seringues ; de l’autre, on fait la chasse aux fumeurs de shit.
Il faut connaître tout ce contexte pour comprendre les débats sur les « salles de shoot ».
Nommée en 1991 responsable d’un centre parisien de soin pour toxicomanes, Sylvie Geismar-Wieviorka est aussi une femme politique, et, en tant qu’élue de Paris, elle a assisté à tous les débats sur ce sujet. Le conseil d’État, consulté trop tardivement, n’a pu que prendre acte des contradictions existantes, et refuser l’expérimentation des salles de consommation supervisée.
Son témoignage et sa réflexion nous aident à mieux comprendre pourquoi les décisions politiques sont éloignées des positions des praticiens de terrain, et imperméables aux données scientifiques les plus solides.
Au goût très français de l’universel et de la polémique – éthique de conviction plus que de responsabilité – s’ajoute la tentation populiste de flatter l’électeur, supposé frileux et conservateur.
Réflexion apaisée, sinon dépassionnée, ce livre est une tentative importante pour reprendre les questions dans le bon sens, celui des réalités quotidiennes plutôt que des grands principes.
Loin d’une grande révolution, l’expérimentation qui commence ce mois de ces salles de consommation sera peut-être un outil pour modifier les termes du débat, et partir des réalités vécues par les usagers et les riverains, sans tomber immédiatement dans les sempiternels effets de manches des « pour » et des « contre ».

Les salles de shoot est une excellente expérience pour éviter plein de maladie voir des décès conte une mauvaise utilisation des seringues alors suite aux résultats dès autre payées q’uils ont pratiqué cette expérience le résultat est très bénéfique en plus sa réduit sur plusieurs années la consommation car ce que est autorisé est moins rechercher en générale alors pourquoi ne pas tester ?.