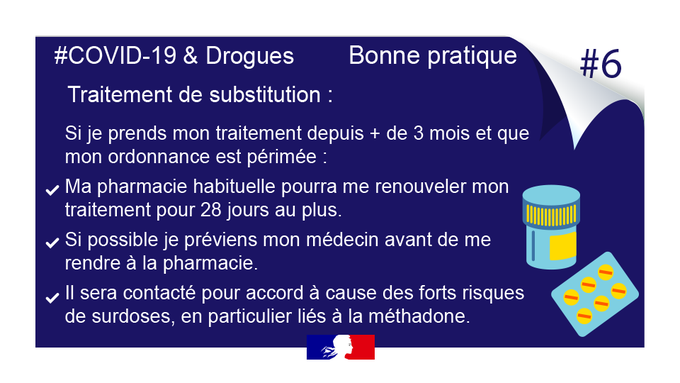par Docteur Marc Valleur, médecin chef du Centre médical Marmottan.
La venue au centre Marmottan de M. le ministre du Budget est un signal fort, dont les soignants ne peuvent que se réjouir, puisqu’elle démontre une volonté politique de prise en compte de la dimension potentiellement addictive des jeux d’argent et de hasard. C’est un signal d’autant plus fort qu’il eût été difficile de l’imaginer il y a seulement quelques années, lorsque l’idée de regrouper le jeu pathologique parmi les addictions, au côté de l’alcoolisme, du tabagisme, des toxicomanies, avait du mal – mais c’est toujours un peu le cas lorsqu’il s’agit de jeu – à être prise au sérieux.
Il est de fait temps que la France prenne la mesure du problème et que se construise une véritable politique des jeux, qui tienne compte du phénomène de société que constitue l’extension de l’offre de jeux, des changements apportés par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, mais aussi de la dimension sanitaire induite par cette évolution.
Les quelques trop rares équipes qui ont commencé à recevoir des joueurs compulsifs, « pathologiques », excessifs, savent la quantité de souffrance que représente cette addiction, pour les joueurs concernés, mais aussi pour leur entourage.
C’est pourquoi, malgré toutes les discussions et querelles d’experts quant au statut des « addictions sans drogues », quant à leur homologie totale avec les toxicomanies ou l’alcoolisme, personne ne songe à nier cette dimension de souffrance, ni la nécessité d’y apporter des réponses, qui doivent comporter un volet sanitaire.
L’expertise collective de l’INSERM aura été la première manifestation d’une volonté de prendre en compte les souffrances liées au jeu excessif, et elle doit être suivie de la première enquête épidémiologique sur le sujet, menée par l’OFDT en collaboration avec l’INPES.
Reste à construire un réseau qui apportera des réponses concrètes en termes de prévention, d’information, et de soins.
La promotion de la notion de « jeu responsable » a été décidée, elle aussi, assez récemment, puisqu’on peut la dater de la création du COJER en 2006.
Cette notion implique une inflexion importante des discours, et de la politique en matière de jeu, jusque là fondée sur une forte canalisation de l’offre, liée à une prohibition millénaire, d’origine religieuse, puis morale.
Ce cadre prohibitionniste n’était pas une absence de politique : les contraintes d’une prohibition, ou d’un certain degré de prohibition, sont dans certains cas le prix qu’une majorité accepte de payer, par solidarité avec les personnes les plus à risque, qui seraient les victimes d’une libéralisation brutale.
Mais remettre en cause ce cadre est cependant justifié par la nécessité de canaliser une offre déjà plus que présente sur Internet. Surtout, l’augmentation très importante de l’offre, évidente depuis 1990, l’évolution qualitative de cette offre, avec la part croissante des « jeux de sensation » par rapport aux « jeux de rêve », finirait par rendre peu crédible un régulateur trop étroitement lié aux opérateurs.
Le projet de loi porte sur un aspect très partiel de l’offre ludique, les paris hippiques et sportifs, ainsi que le poker sur Internet, mais il représente un changement considérable : il s’agit bien aujourd’hui de construire une véritable politique du jeu, dont la prise en compte de la dimension addictive doit être un élément.
Le jeu responsable ne peut simplement signifier que chaque individu sera responsable de sa conduite, face à une offre totalement libre : la responsabilité doit être entendue comme partagée entre les joueurs, les opérateurs, et le régulateur.
On ne peut que souhaiter que les débats soient à la hauteur de l’enjeu : à travers les modes de régulation du jeu, c’est tout un style de société qui se reflètera.
Ces débats sont en quelque sorte une chance unique, qui ne se représentera pas de sitôt, de poser des questions fondamentales en matière d’addictions, avec ou sans drogues.
Une politique de jeu responsable implique une prise en compte de la « pyramide du risque », où l’on voit qu’une partie – la plus importante – de la population joue sans excès et sans dommages. Où la partie « malade », les joueurs pathologiques qui relèvent de soin, ne constituent qu’une petite minorité de l’ensemble des joueurs, sans doute de l’ordre d’un peu moins de 1% de l’ensemble de la population.
Mais il ne faut pas oublier qu’entre ces deux pôles existent tous les problèmes d’abus, de dérapages plus ou moins ponctuels, de pertes de contrôle passagères, qui s’avèrent lourdes de conséquences pour les individus comme pour la société.
La population dans son ensemble doit bénéficier d’une information claire et objective sur le jeu et ses conséquences. Certaines populations vulnérables (les jeunes, les personnes âgées, les pauvres, etc.) doivent bénéficier de mesures d’information et de prévention adaptées. Les joueurs qui manifestent des tendances à l’excès doivent pouvoir être avertis, alertés, avant de se mettre dans des situations irréparables. Les mesures consacrées au crédit sont par exemple ici tout à fait importantes. Et, bien sûr, les joueurs « addicts » ou dépendants doivent pouvoir être reçus dans des centres par des équipes compétentes et formées, et ce devrait être logiquement inscrit dans la mission des futurs CSAPA, qui devraient bénéficier, pour cela, des moyens nécessaires : s’il est bien de doter la prévention par un prélèvement sur les revenus des jeux, il est aussi indispensable que le dispositif de soin en bénéficie.
Mais un tel schéma ne doit pas être conçu comme une simple réponse technique à un problème de santé publique. Les addictions ne sont pas des maladies comme les autres, et, toutes, relèvent d’une dimension politique au sens le plus noble du terme.
C’est pourquoi des tâches importantes attendent la future autorité de régulation des jeux en ligne, mais aussi le futur conseil consultatif des jeux. On peut souhaiter que celui-ci regroupe des représentants des différentes parties prenantes, y compris des défenseurs de la liberté de jouer, et des adversaires des jeux d’argent, qui ont, tous, des arguments à faire valoir. A l’appui de recherches sur le jeu pathologique, mais aussi sur les évolutions du jeu « normal », il pourrait alors devenir l’initiateur d’une politique innovante dans le domaine des addictions.